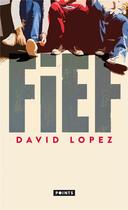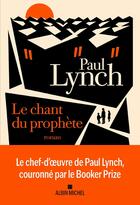"À force de ne rien faire l'ennui devient familier." - Josiane Coeijmans
"Ça ne fait pas une heure que je suis là que déjà je me sens dans mon élément. L'ennui, c'est de la gestion. Ça se construit. Ça se stimule. Il faut un certain sens de la mesure. On a trouvé la parade, on s'amuse à se...
Voir plus
"À force de ne rien faire l'ennui devient familier." - Josiane Coeijmans
"Ça ne fait pas une heure que je suis là que déjà je me sens dans mon élément. L'ennui, c'est de la gestion. Ça se construit. Ça se stimule. Il faut un certain sens de la mesure. On a trouvé la parade, on s'amuse à se faire chier. On désamorce. Ça nous arrive d'être frustrés, mais l'essentiel pour nous c'est de rester à notre place. Parce que de là où on est on ne risque pas de tomber."
Il suffit d’ouvrir certains romans pour s'y couler et s’y sentir bien. Et il y a "Fief". Le moins que je puisse dire c’est que je ne me suis pas du tout sentie à mon aise avec les premières pages de ce roman, le 1er et le seul de David Lopez à ce jour qui reçut le prix Livre France Inter en 2018 après avoir été sur les listes du Renaudot et du Médicis. Pas mal pour une entrée en littérature !
Un fief, de nos jours, c’est quoi ? Un terme tout droit venu du Moyen Âge, bref et sifflant, qu'on lâche avec les lèvres serrées de celui à qui on ne la fait pas, sauf que le fief de Jonas, le narrateur, n'a rien de noble, c'est une zone périphérique, un vague entre-deux, un trou paumé :
"On habite une petite ville, genre quinze mille habitants, à cheval entre la banlieue et la campagne. Chez nous, il y a trop de bitume pour qu’on soit de vrais campagnards, mais aussi trop de verdure pour qu’on soit de vraies cailleras. Tout autour, ce sont villages, hameaux, bourgs, séparés par des champs et des forêts. Au regard des villages qui nous entourent, on est des citadins par ici, alors qu’au regard de la grande ville, située à un peu moins de cent kilomètres de là, on est des culs-terreux."
"Fief", ce sont des journées éternellement recommencées où le temps se répète, monotone, et c’est triste, plat, d’une vacuité confondante. Tout cela transpire la résignation un peu molle. Il faut dire qu'il ne se passe pas grand-chose, alors Jonas et ses potes - Poto et son slam inspiré, Sucré et son surpoids, Miskine et ses embrouilles, Ixe et son herbe à fumette, Virgil, Lahuiss, etc. - se créent des rituels pour habiller leur désœuvrement. Ils épuisent leurs journées à fumer des oinjs, à picoler, à jouer aux cartes, à faire pousser de l'herbe,
"On peut considérer que c'est une manière comme une autre de cultiver son jardin."
à taper l’incruste dans des fêtes, à draguer, à boxer dans la salle de Monsieur Pierrot - plutôt bien d'ailleurs en ce qui concerne Jonas dont le palmarès amateur force le respect :
"Je prends le ring comme un terrain de jeu. C'est le meilleur moyen pour moi de conjurer ma peur. Je me sens comme un torero qui risque sa vie à la moindre passe. Prendre le parti de s'en amuser, c'est ma manière de renoncer à la peur. Sauf que le type en face n'est pas là pour jouer. Il n'est pas là pour me laisser jouer. Je ne peux jouer que contre les faibles. Pour progresser il faut se mettre en danger. Souffrir. Surmonter. Pour ça je dois me faire violence. Ça commence par oublier le jeu. Accepter la peur. Alors je me concentre. Je ne nie plus le danger. Il est là face à moi, c'est lui ou moi."
"Fief", c’est un horizon bouché et visqueux de désillusion, et tous en ont parfaitement conscience. N’est-ce pas Lahuiss qui cite le "Voyage au bout de la nuit" de Céline ? Lahuiss qui, petit à petit, se détache du groupe.
"On devient rapidement vieux, et de façon irrémédiable encore. On s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son malheur malgré soi."
"Fief", c’est le territoire de l’enfance que l’on craint d’abandonner pour l’inconnu que, pourtant, on devine sans surprise. L'avenir pourrait être ailleurs, mais ce n'est pas ainsi que ces jeunes le conçoivent.
"Dans la vie je ne vais que là où j'ai pied. La différence, c'est que dans l'eau je sais quels sont les mouvements à effectuer pour ne pas me noyer."
"Fief", c’est l’absence de modèle à suivre et de route à tracer, c’est pourquoi on reste, malgré tout, le dedans étant plus sécurisant que le dehors, le moindre obstacle ayant raison de leur ténacité. Jonas n'envisage-t-il pas de raccrocher définitivement les gants après une défaite sans appel, faisant fi des espoirs que Monsieur Pierrot a mis en lui ?
Comme il aurait été facile de faire des caricatures de ces jeunes qui se perdent à force de tourner en rond dans l'enclos de leur fief ! Ils ne sont pas exactement la génération perdue chère à Gertrude Stein. Ils incarnent plutôt une génération en perdition et le spleen, comme la flemme, leur collent aux basques.
"Fumer n'était plus l'occupation, on fumait en se demandant ce qu'on allait bien pouvoir foutre. On n'était plus dehors. On s'est enfermés. On a opté pour d'autres jeux. Des jeux auxquels on peut jouer assis."
Cependant, il y a plus particulièrement chez Jonas, le narrateur, une gravité douce et sensible qui affleure sous le masque de fier-à-bras qu’il porte en présence de ses potes.
"Je ne trouve à m'affirmer qu'en affichant mes défauts."
Il est touchant, Jonas, quand il s’autorise à sortir de son rôle et qu'il laisse percer sa fragilité dans un récit second, plus doux et introspectif. Comment ne pas être émue à l’évocation de ses vacances quand il n'était encore qu'un enfant ? Comment ne pas ressentir de l’empathie quand il se retrouve à regretter de ne pouvoir nommer les essences d’arbres de la forêt ?
Ou encore :
"[…] je m'imagine avoir le même destin, un destin qui me permettrait de me rencontrer moi-même, sans les autres, qui ne constituent plus qu'un miroir déformant. Seul sur une île je n'aurais personne à qui me comparer. Et je pourrais travailler à ma survie, pour ne plus avoir à me demander si je vis bien. Heureusement j'en ai trouvé qui me ressemblent. On se soutient dans cet exil. Tous solidaires, ensemble. Tous à vouloir sortir du rang pour se retrouver enfin seuls, et tenter de comprendre ce qu'on est censés faire avec ça."
Malheureusement, cette douceur dit la passivité de Jonas englué dans une torpeur paralysante et culpabilisante.
"Réussir, c’est trahir."
Il y a des phrases qui ne paient pas de mine et qui, pourtant, font plus de dégâts qu’un uppercut :
"Je crois bien que c’est lui qui m’a appris que le seul chemin vers le bonheur c’était la résignation, pas honteuse, mais clairvoyante."
Alors, j’ai eu envie de le secouer pour qu'il ose se faire confiance, de lui botter le derrière pour le faire réagir, lui dont le regard est pourtant si aigu et juste, de le malmener comme lui et ses potes malmènent la langue.
Car "Fief" c'est aussi l’aventure d’une langue, une langue de combat - parfois de combat de coqs qui s'invectivent dressés sur leurs ergots. Elle est dans l'action, heurtée, brisée. Ces jeunes l'inventent, la triturent, la tordent, la dilatent à force de répétitions rassurantes, d’énumérations sans virgule pour combler la vacance de leur vie et chasser l’angoisse hors du fief. La langue comme armure face à un monde qu'ils redoutent. Avec David Lopez, la langue entre en résistance, est elle-même résistance et le lecteur, lui, ne doit pas résister (ce que j'ai hélas fait au début). Ponctuation minimale pour des phrases qui s’étirent, enflent sous le poids des descriptions et des dialogues noyés dans le corps du texte, autant de détails qui nous signalent que nous pénétrons en territoire étranger. Un peu à reculons, dans mon cas.
"Et le mec il arrive, il te tcheke et il te dit ouais, gros, bien ?"
"Je dis wesh me parle pas de ça maintenant, gros, et il fait scuse."
"Fief", c’est une somme de discours dont la discontinuité - expression même de la parole collective - offre au récit sa cohérence. Contradictoire ? Non, car la langue signe l’appartenance de ces jeunes gens à leur fief en même temps qu’elle les y enferme. Certes, on y croise le Candide de Voltaire, Barjavel, Céline, Robinson Crusoe, mais c’est Lahuiss, parti faire ses études en ville, qui les ramène avec lui. Il faut le lyrisme et la poésie des combats de boxe, le rire franc des blagues de potaches, voire le fou-rire libérateur de l'épisode de la dictée pour que le roman, laissant derrière lui la 1re centaine de pages, devienne moins fastidieux avant de s’achever, parfaitement maîtrisé.
Néanmoins, pour que je sois conquise par ce "Fief", il lui a manqué ce supplément d’âme qui aurait pu naître, par exemple, d’une relation au père plus creusée. Reste la beauté presque irréelle de la poétique du vide - je ne vois pas comment le dire autrement - que David Lopez a magnifiquement rendue.
"Je pourrais faire ça pour eux. Ça aurait du sens. Leur montrer qu'on peut se battre. Lutter pour devenir meilleur. Qu'on n'est pas prédestinés. Que le travail peut mener à la récompense. Je pourrais avoir ce rôle. Sauf que moi je voudrais être à leur place. Moi aussi je voudrais être là-haut à regarder quelqu'un le faire pour moi."
"Fief", c'est un 1er roman terriblement tendre et terriblement triste qui, sur le ton tragicomique, raconte comment, par manque d'ambition et d'espoir, il est presque trop simple de bousiller des vies qui méritaient mieux.
"Fief" est le choix de Julie Estève pour cette sélection anniversaire 5 ans des #68premieresfois.
https://www.calliope-petrichor.fr/2020/07/17/fief-david-lopez-éditions-points/