Le revue de presse d'août vous dit tout sur la #rl2016
Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous
gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la
communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !

Le revue de presse d'août vous dit tout sur la #rl2016

La revue de presse livres vous dit tout ce qu’il faut savoir — et emporter — avant l’été !

Littérature et musique furent longtemps étroitement liées. Pour preuve, dans la Grèce antique, un terme commun désignait la forme d’expression artistique qui les réunissait : mousikè. Depuis, chacune de ces deux disciplines a pris sont autonomie, mais pour mieux revenir vers l’autre. Ainsi la littérature se fait parfois la muse inspiratrice de la musique, tandis qu’il arrive que dans certaines oeuvres littéraires la musique ait parfois le premier rôle. Sans oublier l’opéra, le théâtre lyrique et la comédie musicale qui marient art littéraire et musique dans une envolée lyrique puissante.

Membre de l’Académie française, Andreï Makine est un immense romancier, un excellent écrivain dont la plume m’a conquise, une fois de plus avec Prisonnier du rêve écarlate.
Auparavant, j’avais pu apprécier trois autres de ses romans : Le testament français, Une femme aimée et L’Archipel d’une autre vie.
Prisonnier du rêve écarlate débute par un prologue qui met tout de suite dans l’ambiance car voilà un cinéaste franco-polonais qui prépare un film sur les communistes de l’Ouest venus vivre le rêve écarlate en URSS. Abandonné subitement par l’équipe du film, le narrateur est mis en présence d’une vieille femme qui lui raconte l’histoire de Matveï Bélov, consignée dans des carnets ; c’était justement l’homme qu’ils recherchaient.
Aussitôt, je plonge dans cette histoire passionnante faite de bons et surtout de très mauvais moments révélateurs d’une époque, de ce XXe siècle marqué par deux guerres mondiales et par l’effondrement d’un rêve : cette utopie marxiste, ce communisme qui a beaucoup tenté, avant de sombrer.
Matveï Bélov a été amnistié fin septembre 1957. Il a été libéré un mois plus tard, interdit de résidence dans les grandes villes. Il avait été blessé en 1944, accusé de trahison, condamné à huit ans de travaux forcés. Libéré, il a été relégué à Pinéga, bourg rural de l’oblast d’Arkhangelsk, dans la taïga.
Dès le début, je suis intrigué par ce double qui hante Matveï alors qu’il erre sous la neige et qu’il est enfin recueilli par Daria, dans son isba, à Tourok. Tout de suite, violence et férocité se font une place au cours d’un épisode angoissant et plein de suspense.
Tourok est à douze kilomètres du chef-lieu, Pinéga, et c’est un site militaire déserté par l’armée, site que Daria doit garder. C’est là que Matveï raconte et retrouve qui est son double : Lucien Baert.
Retour en arrière, à Douai, où Lucien est né le 10 novembre 1918. Son père se tue en tombant d’un toit alors que Lucien n’a que 6 ans et demi. Dès l’âge de 16 ans, il entre dans les Jeunesses communistes, lit beaucoup et rêve de la vie en URSS où Staline qu’il admire, règne en maître. Lucien est vraiment engagé pour faire cesser la servitude ouvrière. C’est pourquoi il n’hésite pas à demander à faire partie d’une délégation du Parti communiste qui part de Paris le 16 août 1939, pour un voyage d’étude en URSS. Je note au passage qu’un ouvrier de la chaussure de Romans est l’un des vingt membres de ce groupe.
Grâce à ses lectures de Gorki, Lucien connaît le russe et traduit les slogans affichés partout. Déjà, cette société policée l’inquiète et, lors de la visite d’une usine de roulements à billes, il découvre la comédie qui leur est proposée. C’est la même chose dans un kolkhoze alors qu’il apprend, horrifié, le traité de non-agression signé entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique.
C’est quand le train, emmenant le reste de la délégation, part sans lui, que l’histoire de Lucien bascule vraiment. Andreï Makine raconte cela de façon très délicate. C’est tout en nuances mais efficace. De nombreux détails terribles et éloquents émaillent le récit et c’est passionnant.
Lorsque celui qui s’appelle Matveï Belov – vous saurez pourquoi en lisant le livre – réussit à revenir en France, Prisonnier du rêve écarlate change et devient un révélateur d’une époque pas si lointaine. Il est redevenu Lucien Baert et une jeune journaliste ambitieuse lui permet d’écrire ce qu’il a vécu. Andreï Makine rend précisément ce que Lucien doit vivre, les paliers par lesquels il doit passer pour découvrir, s’habituer à ce monde trente ans plus tard.
L’auteur retrace l’actualité, les événements importants parfois oubliés. Fin des années 1960 et années 1970, il tente de vivre dans le monde futile des bobos parisiens et, ce que j’espère vraiment se produit mais je n’en dit pas plus… Si, je dois signaler que Makine égratigne Soljenitsyne et que c’est bien expliqué.
Prisonnier du rêve écarlate m’a procuré beaucoup d’émotions. Que de leçons que ces vies humaines ravagées par la concupiscence, la corruption, l’agent, son poids, l’incompétence et ce goût du pouvoir qui embarque les meilleures idées, les plus généreuses, vers l’absurdité absolue !
Chronique illustrée à retrouver ici : https://notre-jardin-des-livres.over-blog.com/2025/01/andrei-makine-prisonnier-du-reve-ecarlate.html

Ceci est le traditionnel roman de la rentrée d'hiver d'Andreï Makine aux Éditions Grasset, qui ici encore, revient invoquer l'histoire commune de sa Russie natale et son pays d'adoption, la France. Ce titre laisserait rêveur si on ne savait pas que derrière la couleur vermillon ne se trouvait réellement celui de l'enfer totalitaire soviétique, que le pays n'a pas manqué de dissimuler derrière une vitrine exhibée au monde entier, aussi bien alléchante que factice. Cette vitrine qui ne manque pas d'attirer le chaland communiste qui vit loin de cette société écarlate, en l'occurrence ici, le français Lucien Baert, dont la grande qualité humaine s'est avérée devenir sa plus grande faiblesse, son idéalisme et sa confiance profonde en l'homme. Mais, attention, ce récit est présenté comme un roman, s'il y a peut-être eu un Lucien Baert, rien n'en atteste de son authenticité historique. Prenons donc le flou qui entoure volontairement cette histoire pour de la fiction.
La vie de Lucien Baert a tout ce qu'il y a de moins ordinaire, un française encore plus russe que s'il était vraiment né sur le territoire. Il fut ce jeune ouvrier des années 1920 vivant dans le nord de la France à Douai, doté d'une vraie « conscience de classe » en tant que militant de la première heure. Fort de ses convictions, il fait partie de cette délégation autorisée à visiter le pays tant admiré en août 1939, afin de se rendre compte de ce que le communisme pourrait améliorer la société française de la même façon qu'il a contribué à rendre meilleure la société russe et soviétique, du moins selon les dires de ses représentants qui ont savent leur leçon sur le bout des doigts. Une fois là-bas, il va vite se rendre compte que les scènes auxquels ils assistent dans les usines, le bonheur béat de travailler à la chaine ou dans un kolkhose pour un idéal qui les dépasse, n'est qu'une vaste tragi-comédie. D'autant que dès lors qu'il va commencer à vouloir fureter derrière les décors en carton-pâte, et les mines d'heureux citoyens qu'on lui propose, sa liberté va commencer à se retrouver restreinte par les sbires qui l'accompagnent à chaque pas. Dans le train du retour, Lucien va s'échapper du wagon et se retrouver seul sur le quai d'une gare russe, condamné à ne plus pouvoir rentrer chez lui. C'est une vie totalement abracadabrantesque que fut celle de l'homme que nous décrit la voix narrative, qui est littéralement devenu bien malgré lui un pur produit soviétique, de ce soldat qui va se battre au front pour ce pays qui l'a adopté plus que Lucien ne l'a adopté.
C'est une histoire troublante que ce dédoublement de la personnalité de Lucien Baert qui devient Matveï Belov, « le grand Franza », qui va enterrer Lucien pendant un bon nombre d'années. Rescapé des camps, de la Guerre Patriotique, Matveï Belov, va oublier et enterrer sa francité définitivement – et ce n'est pas les quelques années qu'il passera par la suite à Paris qui vont changer les choses – quelque part entre le camp dont il sera prisonnier de nombreuses années après la Guerre, comme un passage obligé vers sa naturalisation russe, comme si le vrai soviétique en devait passer par là pour prouver son patriotisme.
La foi communiste de Lucien a bien vite transmué en une foi bien plus humaniste, à travers le chemin de croix qui est devenu le sien lorsqu'il a manqué le train qui devait le ramener en France : la guerre, les camps, l'exil, le rêve a tourné court certes, mais ce sont les individus sacrifiés à une idéologie dévoyée qui vont lui permettre de survivre, d'abord, puis de vivre ensuite. En grande partie, grâce à Matveï Belov, le soldat qui lui a fait le leg le plus précieux qui puisse être, celui de son identité, car Lucien deviendra Matveï après la mort de celui-ci. Mais ce second Matveï Belov ne redeviendra jamais plus Lucien, prisonnier de cette identité qui lui colle à la peau : le drame, la contradiction, la tragédie de Lucien-Matveï, ce ne sont pas tant ses années de camps, c'est de s'être investi corps et âme dans un rêve qui tenait davantage d'un cauchemar sanglant, d'une utopie brutalement tuée dans l'oeuf.
Encore une fois, j'ai lu un texte fascinant d'Andreï Makine, qui a le don pour chaque fois nous amener l'histoire peu croyable d'un individu qui pourtant n'avait rien pour être exceptionnel au départ. Lire Andreï Makine, c'est mon grand plaisir, tous les deux ans, et il semblerait que le personnage de Lucien Baert ait fait le chemin inverse de celui d'Andreï Makine, qui vit aujourd'hui en France. Une trajectoire de vie qui démontre jusqu'à quel point le totalitarisme soviétique a broyé les individus, jusqu'aux simples Français qui ne demandaient simplement qu'à offrir à leur collègue l'espoir d'une vie meilleure, espoir largement exploité par quelques intellectuels français, qui ont quant à eux se sont bien vite arrêtés aux quelques tours de passe-passe qu'on leur a gentiment présentés. (...)

L'itinéraire d'un “cocu de l'Histoire” parti visiter le paradis socialiste et qui passera vingt ans au goulag avant de retrouver une France où il ne se retrouve plus lui-même.
Auteur discret, Andreï Makine fait partie des grandes plumes du paysage littéraire français (il est membre de l'Académie Française depuis 2016).
Pour autant il n'oublie pas sa Russie natale qui reste au cœur de la plupart de ses ouvrages.
On l'avait découvert avec "L'archipel d'une autre vie", coup de cœur 2016.
On le retrouve ici avec : "Prisonnier du rêve écarlate", un joli titre pour une belle histoire.
L'itinéraire d'un ouvrier du nord, né en 1918, “un an après la Révolution d'Octobre”, qui part visiter la nouvelle patrie du socialisme en 1939. Par un concours de circonstances digne d'un théâtre de l'absurde, il manquera le train du retour et sera rapidement emprisonné dans les camps staliniens.
Interné sous le nom de Lucien Baert, il en sortira vingt ans plus tard sous le nom de Matveï Belov et ne retrouvera la France qu'en 1967 où il ne se retrouve pas lui-même : l'époque est troublée, les choses, les mœurs et les gens ont beaucoup changé.
Dans cette France moderne qui se libère, il est un peu perdu “comme un astronaute égaré sur une planète inconnue”.
Viendront alors quelques succès pour ce “rescapé de l'enfer” et l'intelligentsia parisienne fera de lui un nouveau personnage - c'est l'époque Soljenitsyne (avec qui Andreï Makine règle encore quelques comptes).
➔ Les “prisonniers du rêve écarlate” ce sont ces “communistes étrangers happés par la grande illusion”, qui sont venus se réfugier en URSS au mauvais moment : eux qui fuyaient les guerres ou les fascistes, ils seront happés par le tourbillon paranoïaque de Staline et finiront au goulag. Ceux qui croyaient trouver refuge sous la bannière rouge, se retrouveront bientôt perdus dans la blancheur des steppes sibériennes.
Parmi ces “cocus de l'Histoire” on pourrait croiser “un ancien communiste espagnol après la défaite des républicains”, “un allemand antinazi”, “un japonais qui faisait du renseignement au profit de l'URSS”, la liste pourrait être longue de ces “vies déchirées, fabuleusement complexes et qui vacillent au bord de l’effacement définitif”.
➔ Andreï Makine va nous entraîner dans ce tourbillon de l'Histoire : 50 ans d'Histoire soviétique bien sûr mais aussi, et c'est la bonne surprise, de notre histoire française. Tout cela est filmé en grand-angle dans un travelling historique passionnant qui met en lumière le regard amer et désabusé que le cinéaste porte sur notre époque.
➔ C'est finalement la dernière partie du parcours de Lucien Baert/Matveï Belov qui fait tout le charme de ce bouquin. On y retrouve le souffle glacé de la taïga qui anime les meilleurs romans de l'auteur, on savoure la prose pleine de poésie sauvage qui termine en beauté cette formidable histoire.
Une prose emplie d'humanité pour ces “gens revenus de toutes les illusions et qui retrouvent la simple humanité depuis longtemps perdue ailleurs”, pour ceux qui vivent dans ce “village au milieu des forêts où les gens vous accueillent sans rien demander en échange”.
Une histoire un peu triste mais pas tout à fait désespérée.
Une histoire qui n'était peut-être finalement qu'une simple histoire d'amour.
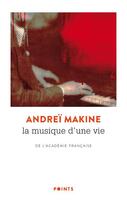
Un grand roman qui nous plonge dans une tempête glaciale au coeur de l'Oural. Une gare, un train qui ne vient pas, une longue attente au coeur de la nuit et c'est la rencontre de deux hommes. Un vieux pianiste remonte le temps de ses souvenirs.
Andrei Makine, de l'Académie Française, a obtenu le prix RTL-Lire pour ce roman d'une écriture délicate et toute en émotions.
 Prisonnier du rêve écarlate
Prisonnier du rêve écarlate
 Prisonnier du rêve écarlate
Prisonnier du rêve écarlate
 Sonerezh ur vuhez
Sonerezh ur vuhez
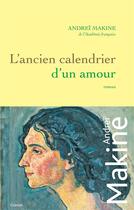 L'ancien calendrier d'un amour
L'ancien calendrier d'un amour
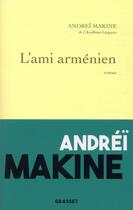 L'ami arménien
L'ami arménien
 Trois roubles
Trois roubles
 Au-delà des frontières
Au-delà des frontières
 Discours de réception à l'Academie française et réponse de Dominique Fernandez
Discours de réception à l'Academie française et réponse de Dominique Fernandez
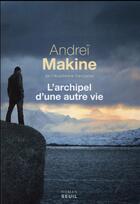 L'archipel d'une autre vie
L'archipel d'une autre vie
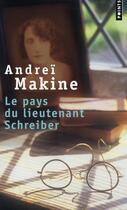 Le pays du lieutenant Schreiber ; le roman d'une vie
Le pays du lieutenant Schreiber ; le roman d'une vie
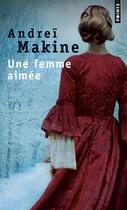 Une femme aimée
Une femme aimée
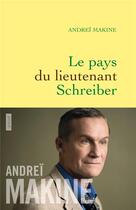 Le pays du lieutenant Schreiber
Le pays du lieutenant Schreiber
Il n'y a pas encore de discussion sur cet auteur
Soyez le premier à en lancer une !

Blanche vient de perdre son mari, Pierre, son autre elle-même. Un jour, elle rencontre Jules, un vieil homme amoureux des fleurs...

Des idées de lecture pour ce début d'année !

Si certaines sont impressionnantes et effrayantes, d'autres sont drôles et rassurantes !

A gagner : la BD jeunesse adaptée du classique de Mary Shelley !