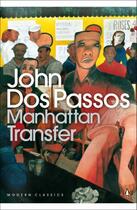Dix ans avant l’invention de la télévision, John Dos Passos inventait le zapping. Le procédé consistant à « engager » une troupe de personnages puis à les mettre en scène à tour de rôle, de façon récurrente, sur de très courtes séquences, le plus souvent par des dialogues sans autre introduction...
Voir plus
Dix ans avant l’invention de la télévision, John Dos Passos inventait le zapping. Le procédé consistant à « engager » une troupe de personnages puis à les mettre en scène à tour de rôle, de façon récurrente, sur de très courtes séquences, le plus souvent par des dialogues sans autre introduction ou explication que l’endroit de la ville où ils ont lieu, fit de ce roman un monument qu’on étudie, aujourd’hui encore, en licence de lettres.
La troupe est nombreuse : Bud le fermier désespéré, Gus le laitier pour qui la chance tourne du bon côté le jour où il se fait renverser par un tramway, Ellen la jolie comédienne de Broadway, Ed Thatcher son père, Jimmy le journaliste, Maisie sa cousine, Georges l’avocat, Tony qui consulte (déjà) un psychanalyste, Joe le spéculateur de Wall Street condamné à la mendicité, Congo le marin qui devient bootlegger pendant la Prohibition en se faisant appeler Armand Duval, aussi comblé qu’était désespéré celui de « la Dame aux camélias », Joe le syndicaliste, Dutch le braqueur…au total une vingtaine de personnages nous accompagnent chaque fois que l’auteur leur donne l’occasion de réapparaître. Ils travaillent, ils parlent, ils rient, ils dansent, ils aiment, ils pleurent, ils boivent, ils réussissent, ils perdent, ils volent, ils mentent, ils meurent… mais la vraie, la seule vedette, c’est New York, qui, à l’époque où le roman est écrit (trois ans avant le Jeudi Noir de Wall Street), ne compte qu’une centaine d’années de développement et devient la ville dominante.
On y évoque la vie urbaine qui dévore le temps et l’énergie des habitants, les immigrants, la faim, l’alcool omniprésent, le travail qu’on cherche, qu’on trouve ou non, les syndicats qui commencent à se créer, les premières grèves, l’argent et Wall Street, les rêves de réussite et d’ascenseur social, les anarchistes, le formidable élan de la construction (bientôt le verre et l’acier remplacent les briques), les paquebots transatlantiques, l’amour, le sexe, les avortements, le divorce, l’émancipation des femmes, la guerre en Europe, les faits divers : incendies, accidents, escroqueries, vols, attaques à main armée, qui constituent un spectacle quasi permanent dans les rues et qui nourrissent les journaux qu’on s’arrache. Il y a aussi la Prohibition qui nous ramène à l’alcool, vraiment très présent même quand il est interdit. On regarde ou on subit la publicité qui envahit les devantures et qui scintille dans la nuit, « Il allait par la ville aux fenêtres resplendissantes, la ville aux alphabets bouleversés, la ville aux réclames dorées ». On sent les murs de la chambre vibrer à chaque passage du métro aérien, on respire les vapeurs d’essence, la poussière, l’enthousiasme et le découragement : « Il se sentait fatigué, malade, lourd de graisse. Un garçon de courses à bicyclette passa dans la rue. Il riait et ses joues étaient roses. Densch se vit, se sentit pendant une seconde, mince, ardent, à l’époque où, bien des années auparavant, il descendait Pine Street, au galop, nu-tête, en guignant les chevilles des femmes. »
On admire au loin « la statue de la Liberté. Une grande femme verte, en peignoir, debout sur un îlot, le bras en l'air.
_ Qu'est-ce qu'elle tient dans la main ?
_ C'est une torche, mon chéri...La liberté éclairant le monde »... et on arpente Manhattan dans un tourbillon, passant de Broadway à Battery Park, déjeunant à l’hôtel Astor, assistant à un match de boxe à Madison Square Garden, attendant, au bord du quai, le Mauretania à défaut du Titanic ou changeant de train à Manhattan Transfer. On ne s’ennuie jamais, on partage espoirs et désillusions ainsi que l’épuisement de ceux qui marchent et piétinent le long des avenues ou dans les couloirs du métro. On est heureux de s’asseoir au bar avec eux et, comme un touriste ravi, d’avoir profité pleinement de cette magnifique promenade dans le temps et dans « la ville qui ne dort jamais ».
Il est temps de refermer le livre, un des personnages quitte la ville dont il a épuisé les joies et les peines. C’est le petit garçon qui admirait, autrefois, la statue de la Liberté avec sa maman. « Le soleil levant le trouve en marche sur une route cimentée entre des terrains vagues pleins de détritus fumants. Il a faim. Ses souliers commencent à faire gonfler des ampoules sous ses gros orteils. A un carrefour, il y a un dépôt d’essence et en face un wagon-lunch, The Lightning Bug. Il emploie soigneusement son dernier quarter à déjeuner. Il a encore trois cents pour lui porter bonne chance, ou mauvaise. Un grand camion d’ameublement, brillant et jaune, vient d’arriver. « Dites-moi, voulez-vous me permettre de monter ? demande-t-il à l’homme aux cheveux roux qui tient le volant.
_ Vous allez loin ?
_ Je ne sais pas trop…assez loin. »
On imagine un vagabond, on pense aux milliers d’autres qui prendront la route en 1929, à Chaplin, et finalement on se souvient qu’on est en Amérique, que demain est un autre jour et que tout est encore possible pour Jimmy. Qui peut dire qu’il ne se relèvera pas ?
Manhattan Transfer est bien un monument, un peu à la manière du Flatiron Building, étrange et singulier mais tellement emblématique de la cité, un monument qui vaut vraiment la visite !