Merci à Joëlle G, lectrice, pour son passionnant reportage
Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous
gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la
communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !

Merci à Joëlle G, lectrice, pour son passionnant reportage
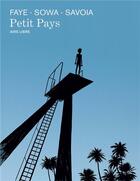
A commenter
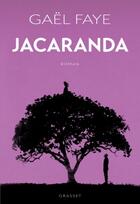
Sacré challenge ! J’avoue que j’étais dubitative quant à l’intérêt d’un nouveau roman sur le Rwanda, par le même auteur…
Et pourtant Gaël Faye m’a embarquée dès les premières pages, par ses mots sobres et saisissants de vérité. Poétiques aussi avec la présence rassurante du jacaranda : « Stella a grandi auprès de son arbre mystique, son ami et confident, une présence rassurante dans une époque tourmentée, une balise fixe dans les remous du temps qui passe. »
Il crée tout de suite, une forte relation de proximité avec son lecteur, grâce au personnage de Milan. Comme nous, il a besoin de comprendre.
Milan est le narrateur, un jeune versaillais, dont le père est français et la mère rwandaise. Sa mère est mutique quant à son passé : « Le passé de ma mère est une porte close. ».
Il a besoin de savoir et retourne à plusieurs reprises au Rwanda. « J’étais perturbé, écrasé par la densité de l’histoire, la petite et la grande, celle de Claude et celle du Rwanda. Leurs douleurs me semblaient incurables. Dans quel marécage intérieur les gens de ce pays pouvaient-ils bien vivre ? »
Un récit passionnant pour la compréhension historique, car il reprend sur quatre générations (avec l’histoire de Rosalie) le passé du Rwanda, les conséquences du colonialisme jusqu’au génocide, jusqu’à aujourd’hui. Sans oublier les responsabilités de l’Occident.
J’avoue aussi que j’ai compris combien, malgré la violence de la guerre civile, il était nécessaire, possible mais tellement douloureux de rapprocher les deux populations.
Un récit passionnant et bouleversant pour l’analyse des répercussions sur la population rwandaise :
- Tout d’abord, les dommages psychiques et physiques du passé, l’impossibilité de résilience car le silence emprisonne la douleur, le ressentiment. « Et puis, en 1994, en plus de nous massacrer, les tueurs ont détruit nos photos. Il fallait nous effacer à jamais, faire disparaître jusqu’au dernier souvenir de nos existences. (…) Tout a disparu, et parfois je crains d’oublier même leurs visages. »
- Puis, le besoin vital de comprendre pour les jeunes générations.
Dans ce magnifique roman, Gaël Faye parle à notre cerveau mais aussi à nos tripes. Comprendre par le cœur, un passé, un génocide, ses conséquences sur la population.
Une profonde et belle réflexion sur « l’après » : « L’indicible ce n’est pas la violence du génocide, c’est la force des survivants à poursuivre leur existence malgré tout »
Jacaranda prolonge et approfondit « Petit pays » dans une langue simple, précise et émouvante. Chapeau l’artiste !
Merci à Imane Doineau ( Les belles lettres) et aux éditions Grasset pour cette belle lecture
https://commelaplume.blogspot.com/
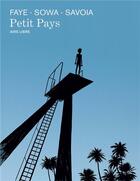
Le roman autobiographique de l'auteur franco-rwandais, Gaël Faye, n'en finit plus de toucher son public.
Publié en 2016, Petit pays a reçu le Prix Goncourt des lycéens la même année, il a ensuite été adapté en film en 2019…
Il ne restait plus qu'à le mettre en images (et en pages) pour percevoir l'intensité de ce récit encore différemment.
C'est chose faite en 2024, avec cette bande dessinée de Sylvain Savoia et Marzena Sowa éditée aux Éditions Dupuis sous le prestigieux label Aire libre.
C'est bien sûr une histoire bouleversante puisqu'elle évoque le conflit rwandais qui a meurtri des générations pour longtemps et a choqué l'opinion publique internationale.
Si la guerre civile entre Hutu et Tutsi était pour ainsi dire latente au Rwanda, c'est suite à l'assassinat du président en place en avril 1994 que les extrémistes Hutu vont se déchainer sur les Tutsi, les rendant conjointement responsables.
Le génocide qui suivra laissera des blessures profondes côté rwandais et au Burundi où se passe la majorité du récit de Gaël Faye puisque c'est là qu'il vivait avec sa famille (un père français, une mère rwandaise).
En effet, la guerre ethnique Hutu/Tutsi dépassait les frontières du Rwanda. Au Burundi, pays voisin, c'est le coup d'État mené par l'armée qui va provoquer le début d'une guerre civile dès 1993 et donner lieu à d'autres massacres (cette guerre civile burundaise ne prendra fin officiellement qu'en 2005 avec la signature d'un accord de paix).
L'histoire de ces événements est complexe, elle ne peut laisser indifférente. Elle nous interroge sur la politique internationale qui n'a pas pris la mesure de ce qui se passait et ne s'est pas donné les moyens pour intervenir et stopper les massacres, et plus tard encore, faire justice (tous les participants au massacre n'ayant pas été jugés).
Gaël Faye fait partie du Collectif des parties civiles pour le Rwanda qui vise à traquer les génocidaires et les traduire devant la justice.
Ce livre est le témoignage d'un rescapé qui porte un regard aigu sur cette période trouble. Les illustrations sont suffisamment évocatrices du choc ressenti : son écho arrive encore aujourd'hui jusqu'à nous pour demander justice.
Ce génocide aura fait 800 000 victimes (tutsi, hutu et toutes ethnies s'étant opposées aux massacres).
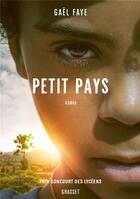
Enfant métisse dans le quartier résidentiel de Bujumbura au Burundi, Gaby vit une jeunesse heureuse avec sa « bande de l’impasse ». Les pères de ces gamins sont pour la plupart des entrepreneurs ou des employés consulaires français et les mères, des réfugiées du Rwanda voisin.
Mais les conflits ethniques entre Tutsi et Hutu dépassent les frontières du Rwanda et lorsqu’éclatent les événements meurtriers de 1994, la vie de ces gamins va voler en éclat. A 12 ans, Gaby à la fois Tutsi et Français, est sorti brutalement de son innocence par la révélation du clivage qu’engendrent ses deux origines.
Au cœur de ce « Petit Pays » qu’est le Burundi, Gaël Faye nous immerge dans l’insouciance d’une vie d’enfant, avec ses joies éphémères, ses réflexions malicieuses et ses heures bien trop longues. Installés dans la carcasse d’une vieille voiture, buvant une bière chaude au « cabaret » ou barbotant dans une rivière à l’eau rouge, c’est toute une ambiance que l’auteur nous fait découvrir et l’imprégnation est tellement puissante, que l’on regarde vivre ces jeunes avec des étoiles pleins les yeux.
Et quand commence le massacre des Tutsis, c’est avec leur regard de gosses tombés dans l’âge adulte bien avant l’heure, que l’on perçoit toute l’incompréhension et le déchirement de ces enfants jusque là épargnés par une guerre ethnique qui les dépasse.
Un roman qui parle magnifiquement de l’enfance et de son innocence, et nous en arrache violemment avec la dure réalité d’un génocide sanglant.
Une révélation à lire absolument.
Il n'y a pas encore de discussion sur cet auteur
Soyez le premier à en lancer une !

Taïna, indienne des Caraïbes, a été instruite dès son enfance pour devenir chamane, mais Christophe Colomb et les Espagnols arrivent...

Une belle adaptation, réalisée par un duo espagnol, d'un des romans fondateurs de la science-fiction, accessible dès 12 ans.

Merci à toutes et à tous pour cette aventure collective

Lara entame un stage en psychiatrie d’addictologie, en vue d’ouvrir ensuite une structure d’accueil pour jeunes en situation d’addiction au numérique...