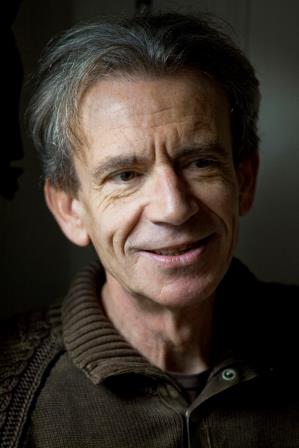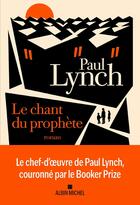Dans son nouveau roman, La Splendeur dans l’herbe (P.O.L), qu’on attend depuis La vie est brève et le désir sans fin (Prix Femina 2010), Patrick Lapeyre met en scène la mélancolie souriante et la fragilité du désir contenu.
Sybil et Homer sont les deux laissés pour compte de conjoints qui les ont quittés pour partir ensemble. Ils se retrouvent et commencent à trouver du charme à leurs conversations. C’est furtif, inavoué, plein de grâce et d’un irrésistible suspens amoureux.
- Vos livres ne sont pas faciles à résumer. Comment vous y prendriez-vous pour raconter La Splendeur dans l’herbe ?
On ne peut pas « pitcher » mes livres de façon rapide et simple. Beaucoup d’auteurs travaillent sur des sujets sociaux ou des drames, il leur est plus facile de cerner leur propos. Et puis je crois qu’on n’écrit pas pour délivrer des messages : j’écris pour que les lecteurs voient leurs vies. Il n’y a jamais rien de spectaculaire ni de saisissant dans mes livres. Le spectaculaire, c’est du bluff qui ne fait pas écho à la vie du lecteur. La vie réelle se déroule toujours à basse intensité. Avec des événements discrets. L’amour est comme une suite d’événements discrets qui consistent à se frôler ou marcher ensemble, se sourire, ce genre de choses ténues. J’espère que mes livres agissent comme un instrument optique qui permettrait au lecteur de voir et de prendre non seulement conscience de sa propre vie, mais de la vie dans le sens de ce frisson métaphysique qui nous traverse. Je ne pense pas qu’un roman ait pour objet de distraire le lecteur mais, s’il a une fonction, ce serait plutôt celle d’intensifier et de poétiser la vie du lecteur. Si j’ai réussi mon coup, le lecteur respire plus amplement après avoir refermé le livre.
- Deux personnes se retrouvent à nouer des liens sur le dos de leurs ex partis ensemble. C’est un drôle de point de départ pour un livre qui n’est cependant pas un vaudeville !
J’ai revu In the mood for love, de Wong Kar-wai, un film que j’aime beaucoup. Un homme et une femme se rencontrent dans une pension de famille et s’aperçoivent qu’ils ont tous deux été quittés par leur conjoint respectif. Ce qui me plaisait dans cette idée c’est que Kar-wai a imaginé une histoire du point de vue des perdants. On choisit toujours le camp des vainqueurs, dans la passion amoureuse, mais les autres ? On considère les deux autres, restés comme des colis en souffrance, au mieux comme des encombrants. Je voulais renverser le point de vue et me demander comment on construit un amour sur les ruines d ‘un autres. La question m’intéressait, qui est universelle au vu du nombre de familles recomposées. Par souci d’efficacité narrative, j’ai fait en sorte que les conjoints soient partis ensemble à Chypre.
Quand j’enseignais la littérature aux adolescents, et que j’évoquais la passion, je m’apercevais qu’être amoureux allait de soi pour eux, qu’ils se sentaient capables de tomber amoureux toutes les semaines. La question qui leur faisait peur était plutôt « Est ce que je peux être aimé ? » Quand on devient adulte, on découvre que ce qui est difficile c’est d’aimer, être aimé est un faux problème.
- C’est à dire ?
La société d’aujourd’hui limite notre capacité d’aimer. J’avais été frappé par la phrase de Dostoïevski qui dit que « l’enfer c’est de ne plus pouvoir aimer ». Je voulais pour ce livre un personnage qui ait senti « le vent du boulet », comme on dit, qui ait touché du doigt la possibilité qu’il pourrait ne plus aimer.
- Parlez-nous d’Homer : cet homme trop grand, trop timide, décalé, à commencer par son prénom…
C’est en regardant des aquarelles de Winslow Homer que j’ai été frappé par ce nom.
Le personnage est décalé, en retard, timide, hésitant, c’est le type de personne que j’aime bien dans la vie. Je trouve à la timidité un charme, la marque d’une sorte d’intériorité. Et une fois qu’on a trouvé le nom, on a trouvé le ton, le niveau stylistique du livre.
- On dirait que l’amour courtois qui existe entre Homer et Sybil pourrait durer éternellement, alors que le franchissement amoureux semble en menacer la pérennité : le passage à l’acte condamne-t-il leur histoire ?
Intuitivement, quand Homer repousse indéfiniment l’accomplissement qu’attend le lecteur, il le fait parce qu’il devine que c’est le désir qui les fait vivre et que le plaisir peut signer la chute de ce désir. Il apprendra au cours du livre qu’il faut avoir la sagesse de se résigner à ses propres limites. Ils sont avec Sybil sur un seuil, sur ce que l’ethnologue Bronislaw Malinowski a appelé le plateau d’intensité. L’accomplissement devient un événement secondaire. J’ai beaucoup pensé à la musique répétitive pour construire cette relation immobile. Chaque séquence entre les deux personnages est une variation par rapport à la précédente. L’expérience est hypnotique, hors du temps.
- Pourquoi avez-vous choisi pour exergue un poème de William Wordworth ?
Le livre devait s’appeler Silenzio, titre pris 4 fois, donc j’ai été obligé de réfléchir. En fouillant dans mes carnets, j’ai retrouvé ce titre, Splendor in the grass, tiré du poème de Wordworth et qui est aussi celui d’un film d’Elia Kazan (traduit par La Fièvre dans le sang). J’aimais ce passage du poème qui a une nostalgie de la beauté, de la pureté et de l’innocence qui me semblent habiter mon personnage. Sans expliquer Wordworth, ce titre renvoie à l’innocence, à un monde ouvert devant nous, celui de l’enfance, de l’adolescence, où l’on est heureux et où l’on a l’impression de recevoir la luminosité des choses. C’est exactement ce qui se passe pour les personnes du roman, qui subsistent sur les ruines de leurs amours, et qui cherchent la force de vivre dans ce qui leur reste.
J’aime les titres énigmatiques car ils sélectionnent leurs lecteurs. Les lecteurs s’attachent rarement au nom de l’auteur, l’enjeu d’un livre se joue sur le titre. Par exemple, A l’ombre des jeunes filles en fleurs déroute ou attire. J’aime la vibration poétique des titres car j’ose penser que mon travail est poétique. Je ne cache pas de secret dans mes livres, chacun y trouve sa vérité.
- Il vous faut cinq ans en moyenne pour écrire un roman. Qu’est-ce qui vous prend le plus de temps, l’écriture, l’idée, la rêverie ?
Je trouve très difficile d’écrire un livre tous les ans. Pas pour une question de scénario, mais pour reconstituer une langue pour le livre. Aujourd’hui, on écrit avec les débris d’une langue, si l’on se compare avec les auteurs ne serait-ce que du XIXe siècle, qui jouissaient d’une langue extraordinaire et qui n’est plus.
- Nous parlons pourtant bien encore le français...
Certes, mais autrefois, on faisait du latin, du grec, on apprenait un français exigeant. Tout cela est loin, et nous n’avons plus la même culture rhétorique. Les réformes en cours ne font que confirmer des tendances amorcées dans les années 60, au profit des sciences, notamment. Lira-t-on encore dans quelques années ? Je n’en sais rien et j’aurai fermé les yeux pour de bon avant de le savoir. Peut-être que certaines villes comme Paris fonctionneront comme des isolats culturels, avec des musées, des cinémas, des lieux consacrées à la littérature, dans un territoire totalement déserté par ces valeurs. Je redoute des cassures sociales plus violentes qu’aujourd’hui, avec deux populations qui n’auraient alors plus rien à se dire ni à partager.
Propos recueillis par Karine Papillaud